Patrick Straram, index/indices
Patrick Straram (Paris, 12 janvier 1934 – 3 mars 1988) est un écrivain québécois d’origine française qui a participé à l’aventure de l’internationale lettriste de 1950 à 1953. On lui doit, passée cette courte période – mise en lumière à partir de documents inédits en 2006 dans une perspective de dépassement du “debordocentrisme” de l’internationale lettriste et a fortiori de l’internationale situationniste –, des ouvrages consacrés à la littérature (le théâtre surtout et des poèmes consubstantiels à la musique qu’il affectionnait. Il emprunta, dans la dernière partie de sa vie (l’époque “hippie” québécoise de Straram, pour raccourcir) à Boris Vian, autre grand amateur de jazz, le pseudonyme de Bison Ravi (anagramme de “Boris Vian”). Il proclame à ce sujet “Mon nom n’est pas Patrick Straram, mon nom c’est Patrick Straram le Bison Ravi”. Il est par ailleurs le petit-fils du musicien Walter Straram (anagramme de Marie Émile Félix Walter Marrast, un des grands noms de la musique dans l’entre-deux guerres) et le fils d’Enrich Straram, directeur du Théâtre des Champs-Élysées. En ce sens, il constitue le chaînon idéal et manquant entre un Debord dont l’intérêt pour la musique moderne semblait limité ( amateur de musique baroque et de musette, on sait qu’il admirait quelques grands disques de jazz, comme en témoigne l’utilisation d’un titre d’ Art Blakey and The Messengers – Whisper Not (1958) – dans In girum imus nocte et consumimur igni…
Au-delà de cela, le directeur d’internationale situationniste a persisté d’ignorer les convulsions du rock et de la folk music – fait relevé avec pertinence par Toulouse-La-Rose dans son petit opuscule Pour en finir avec Guy Debord –, tout comme il ignora l’histoire moderne renouvelée par l’École des Annales ) et un Vian chroniqueur fou et trompettiste blafard, hanté par la passion des thriller à l’américaine…
D’ailleurs, c’est en 1979 que Straram consacrera pas moins de cinq émissions radio à Boris Vian. Straram, c’est le pendant inacceptable de Debord – quoique ce dernier le désignât comme l’auteur de la “première déclaration situationniste exprimée” –, il est voyageur, il aime le rock anglo-américain, il a sali ses mains pour des salaires et – Ô misère ! – il s’éprenait de Resnais, de Queneau, de Deleuze et tant d’autres bourgeois… parmi lesquels l’un est encore plus intolérable que les autres : “le plus con des Suisses pro-chinois”, Jean-Luc Godard.
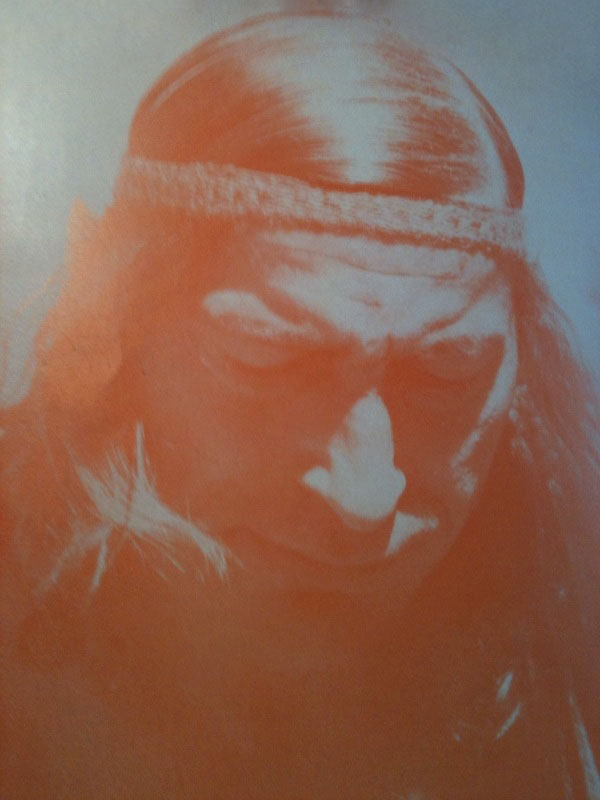
Straram aimait passionnément les disques (on lui vola sa conséquente collection au début des années 1980 ainsi que son matériel audio, un coup fatal alors qu’il est obligé de se réfugier chez une amie à Longueuil, Francine, à l’endroit de Montréal dit “Rive Sud” et quartier populaire de HLM). Nombre de ses poèmes sont autant d’envolées lyriques (il aime par ailleurs les litanies dans ce style cher à Malcolm Lowry, dont il admire Au-dessous du volcan) consacrés au groupe de l’Ontario The Band (il voue un culte sans limites au titre The Weight et à l’album The Big Pink– qui apparaît dans la bande originale de Easy Rider de Dennis Hopper qui s’est éteint aujourd’hui 29 mai 2010), mais aussi au Grateful Dead de Jerry Garcia, aux Rolling Stones, à Dylan… Straram ainsi, dans une idiosyncrasie teintée d’éthylisme, est le plus aventurier et moderne de ses (ex-) compagnons de dérive volontiers plus ancrés du côté de la Renaissance et de la belle langue que dans la transfiguration folk de San Francisco. Pourtant, il représente un trait d’union entre les avant-gardes et la contre-culture, et tant va le tricard à l’art spectaculaire qu’à la fin on l’oublie.
Pour exprimer son déracinement inévitable et l’importance de son émigration, il empruntait à Brecht la citation suivante : “La meilleure école pour la dialectique, c’est l’émigration. Les dialecticiens les plus pénétrants sont exilés”.
Il est vrai qu’en France, nous (disons, le large public sensible à TOUS les participants aux avant-gardes) connaissons Straram que depuis la réédition de ses textes sous l’impulsion roborative d’un tandem d’universitaires, Boris Donné et Jean-Marie Apostolidès, à travers trois textes : Les Bouteilles se couchent (Allia, 2006), La veuve blanche un peu détournée (Sens & Tonka, 2006), Lettre à Guy Debord (Sens & Tonka, 2006).
Aussi un répèrage bibliographique, que l’on complétera pour avec l’excellent inventaire du fonds Straram dressé en 2003 par Hélène Blain pour la BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Montréal), donnera un autre éclairage qu’un portrait de Straram en ami dériveur de Debord, de façon à présenter ce probable renégat, par sa sensibilité au mouvement hippie, aux manifestations que les orthodoxes de l’IS auraient jugées comme de méprisables manifestations spectaculaires. Pourtant, de nombreuses similitudes avec le jeune Debord sont frappantes, ainsi l’admiration portée à Sartre (Debord a plutôt dissimulé cela, mais Boris Donné a démontré habilement comment Sartre est référent chez lui), notamment à travers une fascination pour le roman L’Âge d’homme (1945) et la portée du genre autobiographique, ainsi qu’une poétique des lieux et surtout de la ville stimulée par l’absorption de quantités d’alcools inconcevables.
Enfin, l’itinéraire de Patrick Straram relate l’expérience d’un français déraciné, ayant jeté les amarres au Québec après quelques années en temps qu’employé forestier dans la région de Vancouver. Straram, arrivant avec le désir jamais émoussé d’une subjectivité radicale, constate le degré d’immission du capitalisme dans la vie et la culture québécoises. A son arrivée, il constatera d’ailleurs que Radio-Canada joue un rôle similaire à celui de la moribonde ORTF en France à la même époque.
Straram fut attiré par l’exil comme telle masse liquide par l’attraction des astres ; en témoignent ces quelques lignes :
« L’obligation de m’arracher au Québec, de m’exiler encore une fois, puisque tous les journaux, les postes de radio, la télévision, l’enseignement m’y étaient interdits, le mal dégueulasse que cela fait, il n’est pas prêt de cesser, la plaie n’est pas prête de se cicatriser, chaque jour ailleurs qu’au Québec la rouvre, ça vous fouille jusqu’à l’os, il y a de brusques arrêts du coeur, de longs temps de nostalgie, de prostration, qui font vomir…»
La thématique du déracinement et l’expérience américaine sont séminales dans les écrits de Straram. Après avoir vécu en Californie et au Canada, impossible pour lui d’envisager à nouveau la France. D’ailleurs, il ne peut plus y pénétrer, puisqu’il est déserteur. Il éprouve même une sympathie marquée pour le nationalisme québécois et la présence la langue française.
Si la bibliographie de Patrick Straram tient dans un mouchoir de poche, gageons qu’un certain nombre des archives qu’il a léguées à la Bibliothèque nationale et archives du Québec (alors que la maladie lui rongeait les poumons) permettront l’établissement de nouveaux corpus et de donner un éclairage autre sur ceux que l’on considère comme les moins-que-rien des dernières avant-gardes post-surréalistes francophones.
Repères bibliographiques
Établis à partir des notices de WorldCat, de la BAnQ, et d’ouvrages rares consultés à la BNF (certains consultables sous surveillance !)
- Cahier pour un paysage à inventer, revue, 1960.
- One+One Cinemarx et Rolling Stones. Montréal : Les Herbes rouges, 1971.
- Gilles Groulx, le Lynx inquiet. Patrick Straram ; Jean-Marc Piotte. Montréal : Cinémathèque québécoise/Editions québécoises, 1971.
- En train d’être en train vers où être, Québec … : graffito folk-rock de Patrick Straram, le bison ravi, Patrick Straram. Montréal : L’Obscène nyctalope, 1971. (NB : texte également repris dans l’ouvrage suivant)
- irish coffees au no name bar & vin rouge valley of the moon. Montréal : L’Hexagone/L’Obscène nyctalope, 1972.
- Questionnement socra-cri-tique. Montréal : L’Aurore, ©1974. (Coll. “Ecrire”, 2).
- Littérature et politique. Patrick Straram ; André Belleau ; et al. Longueuil : Stratégie, 1974.
- La Faim de l’énigme. Kamouraska : Éditions de l’Aboiteau, 1975.
- Bribes 1. Pré-textes et lectures. Montréal : L’Aurore, 1975. (Coll. “Ecrire”, 11)
- Bribes 2. Le bison ravi fend la bise. [Montréal] : L’Aurore, 1976. (Coll. “Ecrire”)
- Blues clair ; Quatre quatuors en trains qu’amour advienne. Patrick Straram ; Francine Simonin. Saint-Laurent, Québec : Éditions du Noroît, 1984.
- Les bouteilles se couchent, éditions Allia, Paris, 2006 (Texte retrouvé aux Archives nationales du Québec et édité par B. Donné et J‑M. Apostolidès, suivi d’une notice fort éclairante de ces derniers).
- La Veuve blanche et noire un peu détournée, éditions Sens & Tonka, 2006 (Texte édité et préfacé par B. Donné et J‑M. Apostolidès et suivi d’un ensemble métagraphique et biographique de l’auteur)
- Lettre à Guy Debord (1960), éditions Sens & Tonka, 2006
Articles parus en revues
- “P.S. Post-Scriptum harmonial”, in Le Tremplin, n°63, novembre 1953, p.4
- “L’air de nager” (1960, dans Cahier pour un paysage à inventer, 1, Montréal)
- “Tea for One”, in Écrits du Canada Français, 1960.
Collaborations
- “Tea for one 2 hypojazz ; Electronic music for mind and body”. Patrick Straram, in Musiques du Kébèk, dir. Raoul Duguay, Montréal, Éditions du Jour, 1971
Divers
- “To a strange night of stone”, postface à Pornographic Delicatessen, de Denis Vanier, 1968, Éditions de l’Estérel.
- “Wolf House & Cabaret de la dernière chance, François de la Panam”, postface à Le talon de fer de Jack London, 1972, éditions L’Étincelle.
- “De la nécessité d’une effraction poétique intense à l’intérieur d’une société de répression dont l’objectif révolutionnaire est récupéré par toutes sortes de libéraux, agents les pires de tous les fascismes à venir”, préface à La maladie est en eux, ce sont des chiens de Denis Vanier, 1972, éditions Parti Pris.
- “Métis et fleur bleue”, pour Les grands spectacles de Lucien Francœur, 1974, L’Obscène nyctalope.
Ouvrages critiques consacrés à Patrick Straram
- L’arpenteur de la ville : L’utopie urbaine situationniste et Patrick Straram, Marc Vachon, 2005, Éditions Tryptique.
Webographie
http://www.revue-analyses.org/index.php?id=630
http://remue.net/spip.php?article1659
http://www.ababord.org/spip.php?article95
http://www.archipel.uqam.ca/2516/1/M11033.pdf (Mémoire de Maîtrise de Xavier Martel, enseignant à l’UQAM)